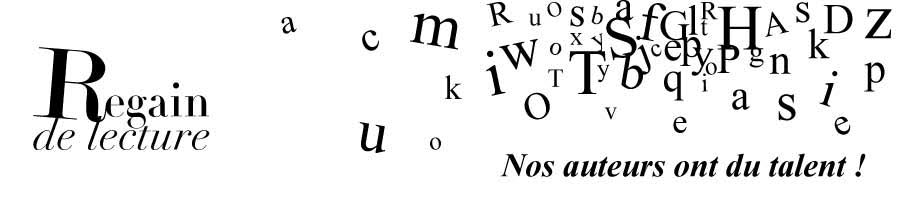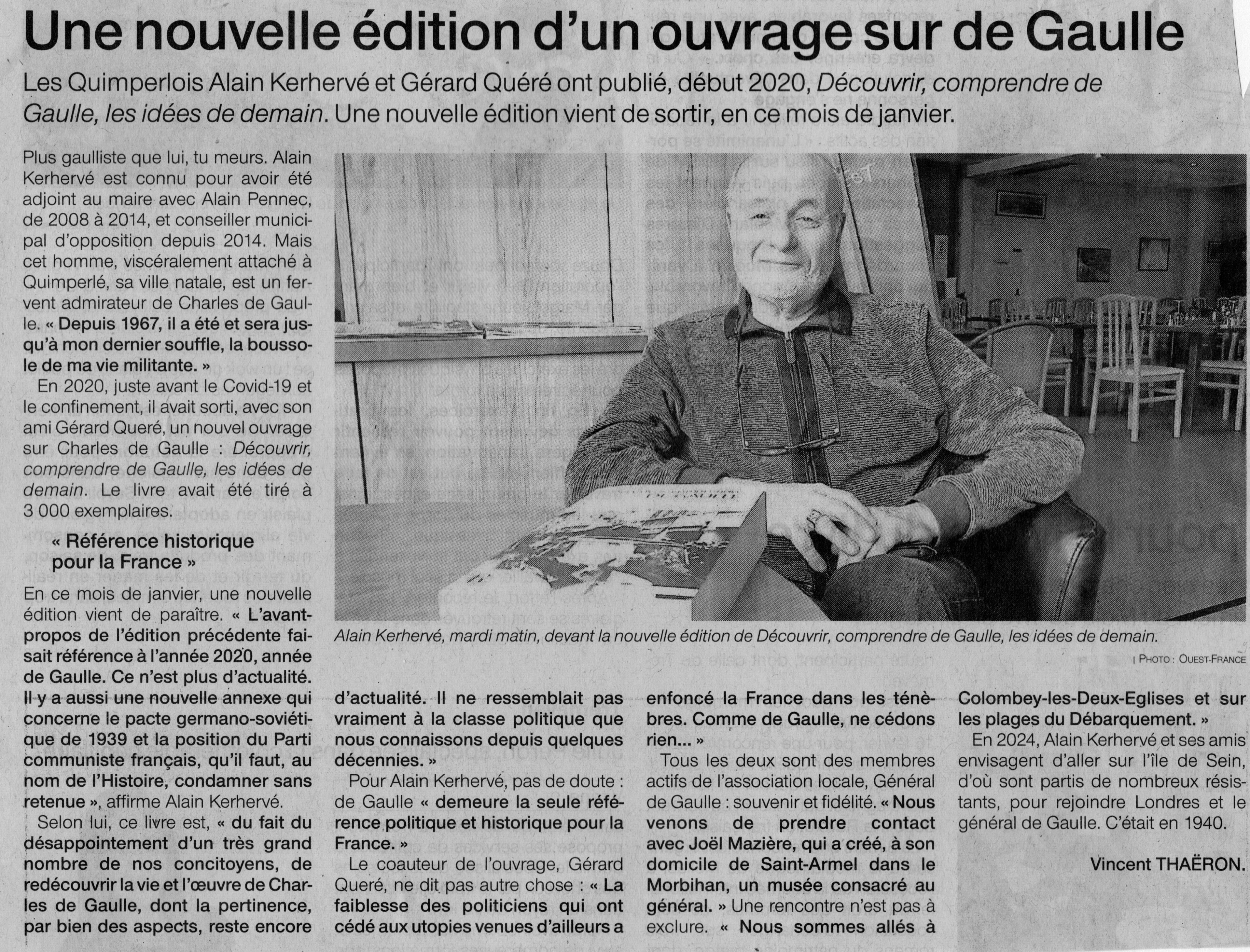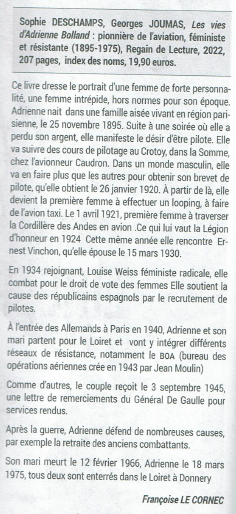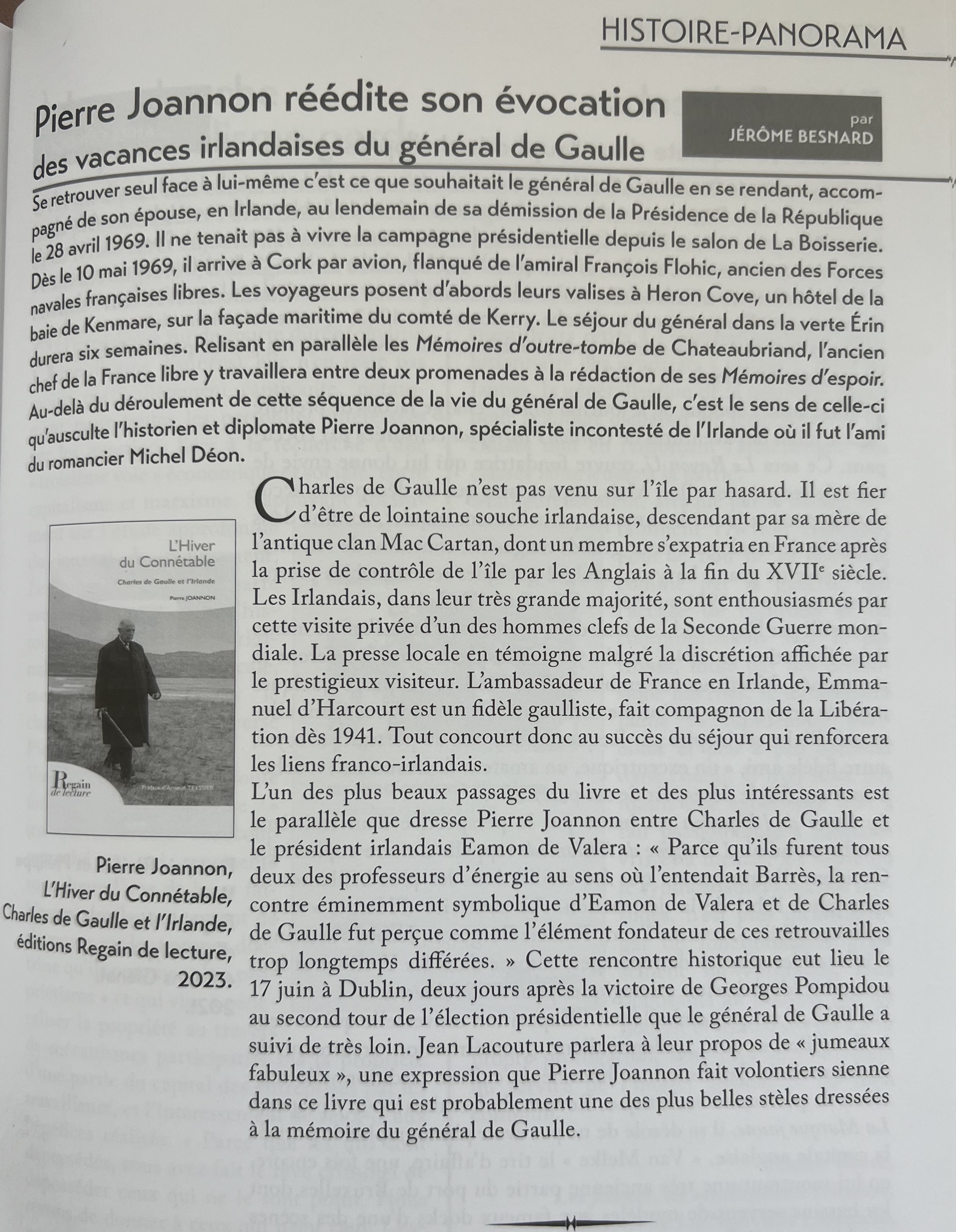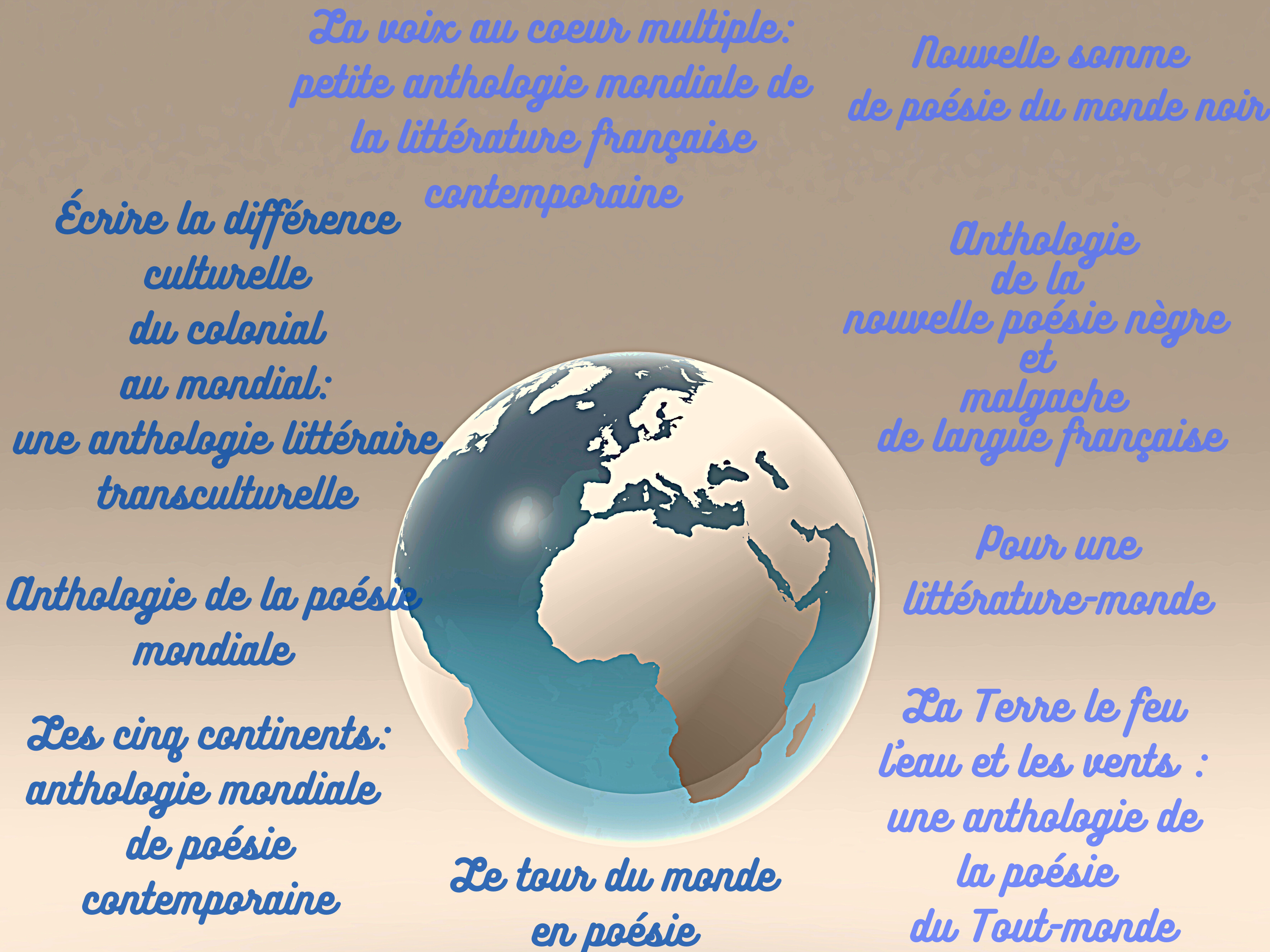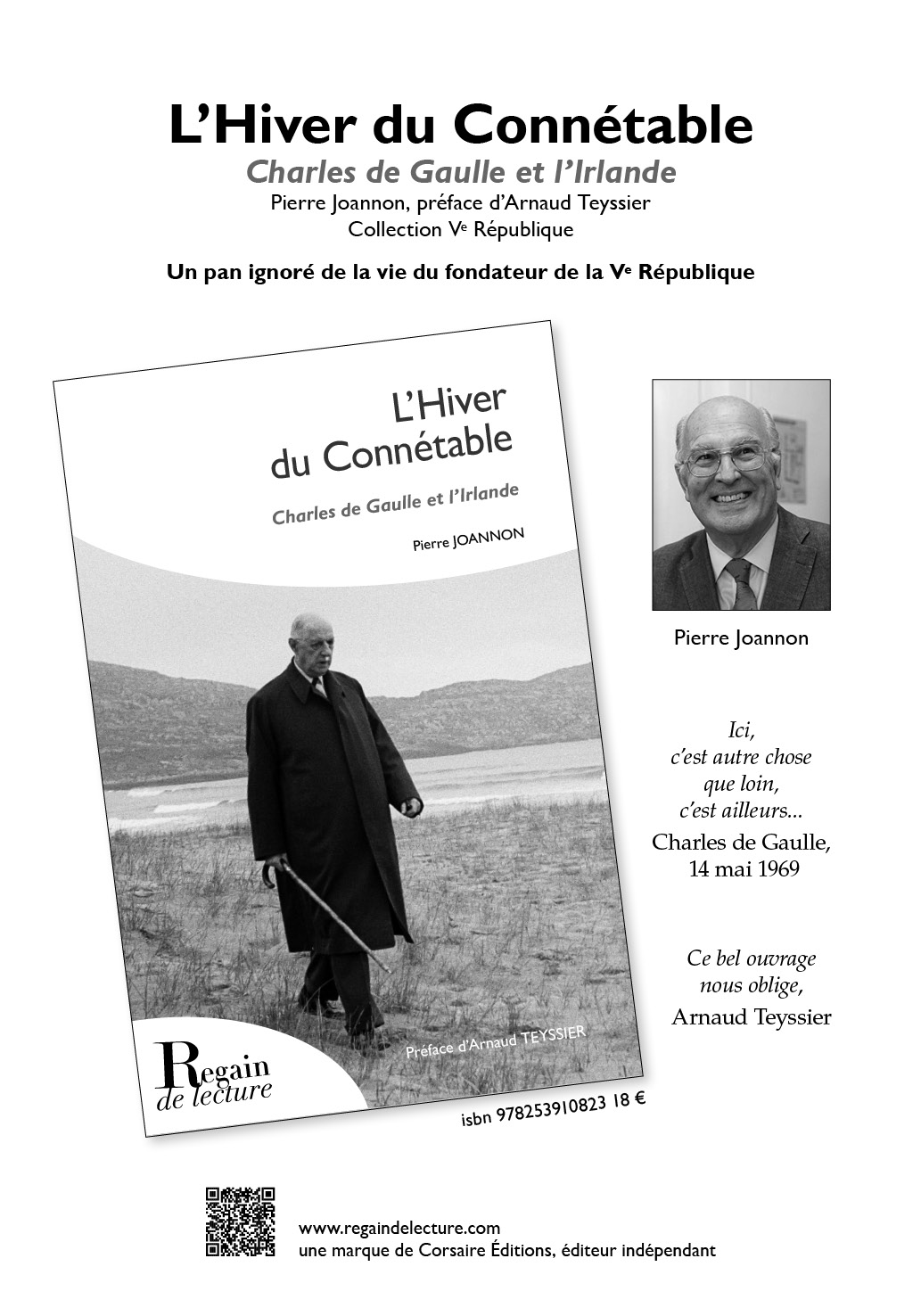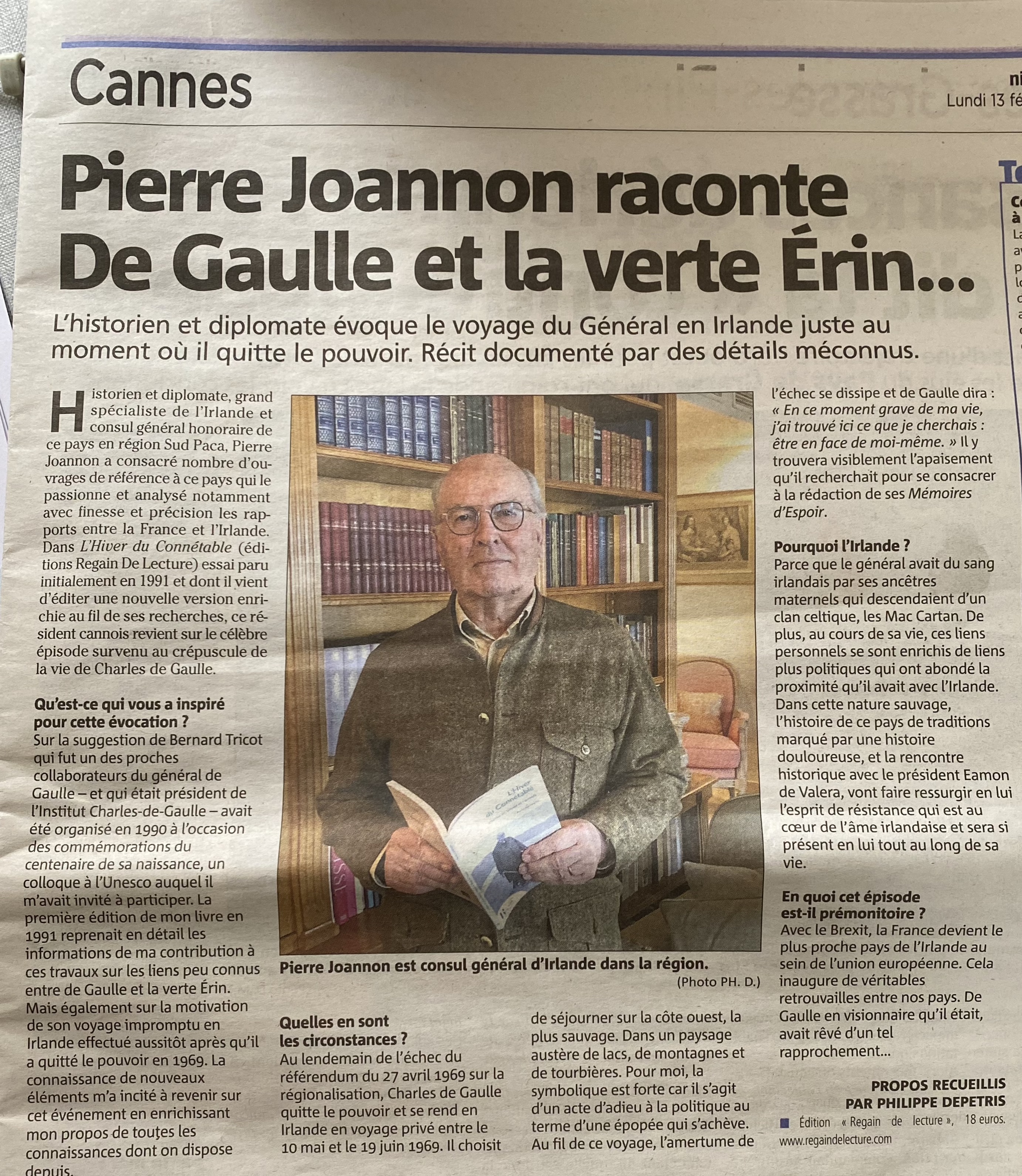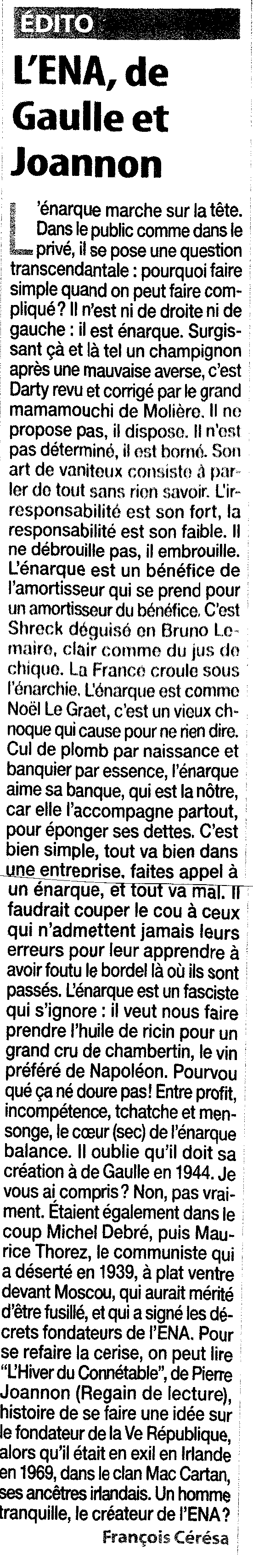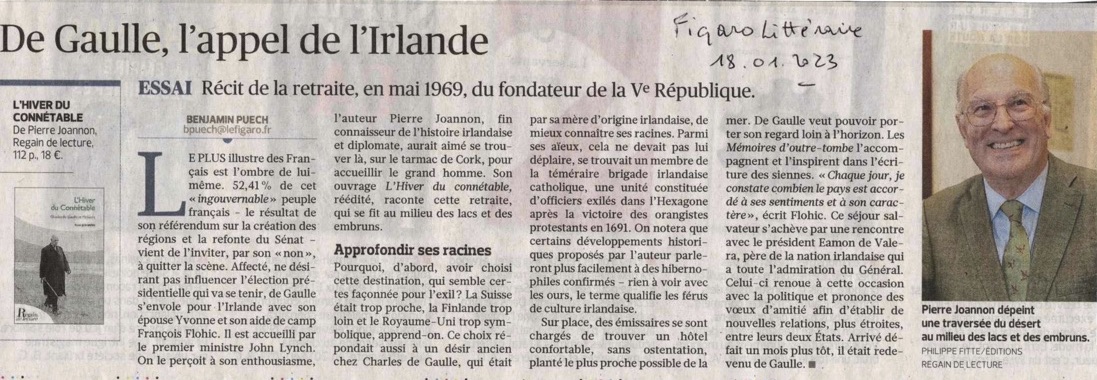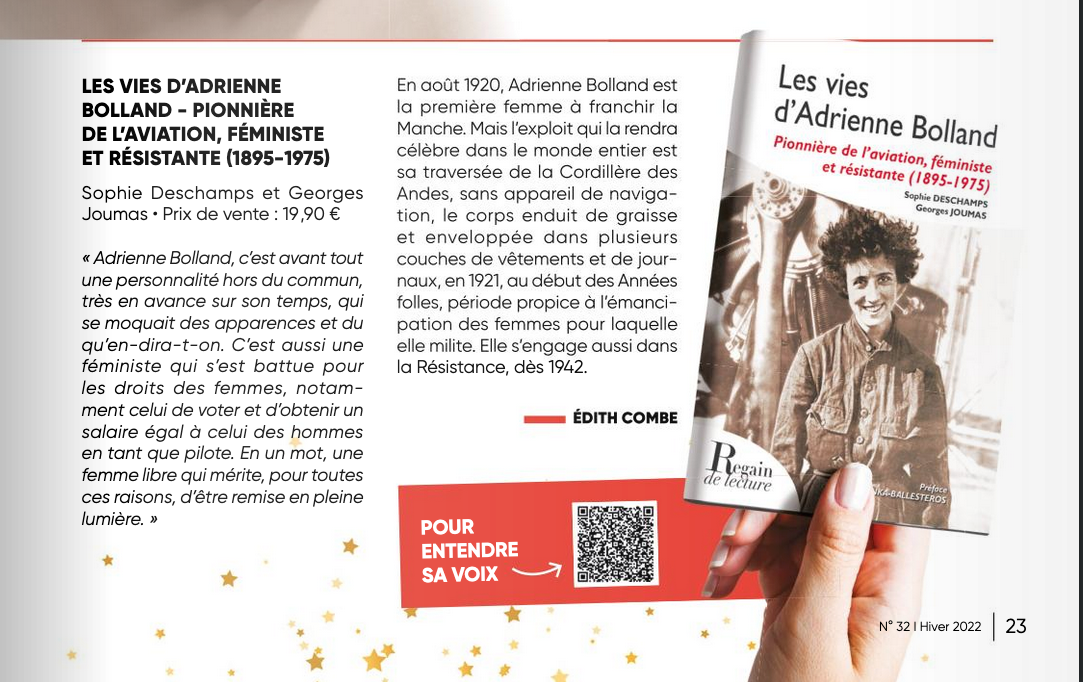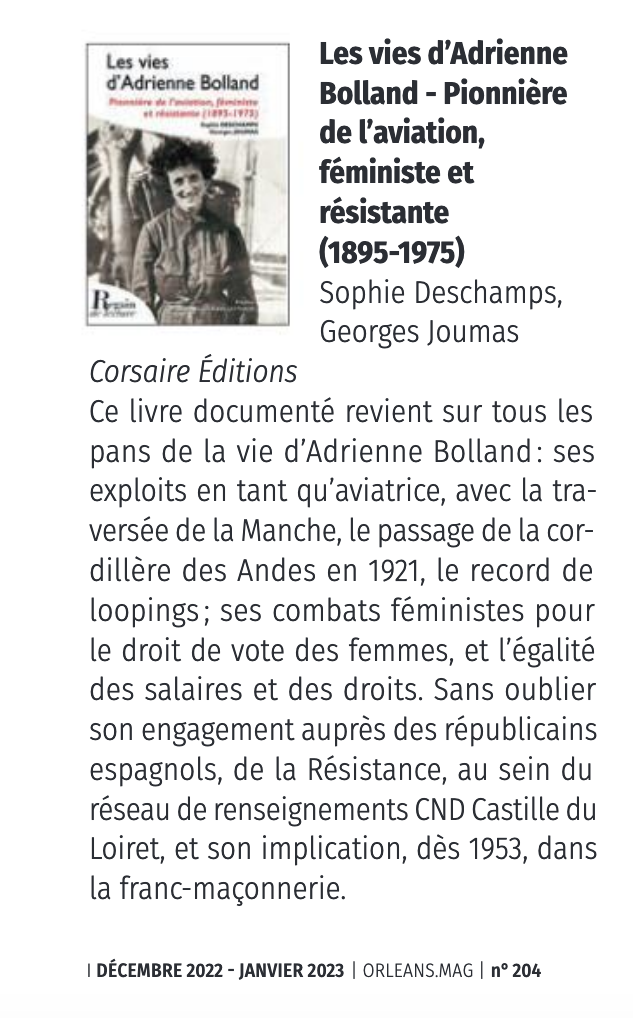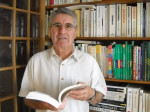C’est avec plaisir que nous retrouvons le jeune Silvère cinq ans plus tard.
« L’année des demoiselles » fait suite à « La Table d’ardoise », romans d’apprentissage qui nous content la jeunesse d’un jeune solognot au Domaine de La Rougellerie où son père, Edgard, occupe la profession de garde-régisseur.
Nous sommes en 1964 et notre héros entame sa quinzième année. Une année bien mouvementée, de nombreux événements, souvent tragiques pimentent le récit de ce deuxième tome.
Cela commence bien mal, puisqu’en février, Silvère perd sa maman adorée, Lucienne, et devra se relever grâce à la gentillesse et la bienveillance de tout le personnel du Domaine et de son papa, qui malgré la charge de travail, veille tendrement sur lui.
Dans un premier temps, il se replie sur lui-même, aménage sa chambre dans les combles des communs et confie ses sombres pensées et ses secrets au portrait de sa maman. Puis avec le printemps, il prend conscience du retour à la vie en observant les verts tendres de la végétation renaissante et le ballet des demoiselles, ces jolies libellules bleues. La nature ne meurt, elle, jamais et il doit en être pareillement pour la nature humaine.
Puis il y a les autres demoiselles, Jacqueline, la fille du fermier, sensiblement du même âge que Silvère, et Gwenllawouen, une jeune fille de vingt ans, débarquée quelque mois plus tôt de sa Bretagne natale, toutes deux employées comme domestiques au château. Après leurs journées detravail au service de Monsieur et Madame ou pendant leurs moments de liberté, elles retrouventSilvère pour écouter Salut les Copains à la radio où en soirée les programmes de la télé.
La canicule sévira cet été-là, néanmoins, les distractions seront nombreuses. L’arrivée d’un camp de scouts sur l’exploitation permettra à notre jeune homme de participer aux activités et de découvrir la camaraderie. La période estivale sera ponctuée, également, des activités du Domaine, grande chasse, battage, sans oublier aux alentours les fêtes traditionnelles des villages. De quoi reprendre goût à la vie, mais la disparition d’un scout et le décès d’un participant à la grande battue vont vite plomber
cette belle euphorie.
Quarante ans plus tard, un épilogue inattendu nous apporte la réponse à ces malheureux faits divers. La lecture de ces deux tomes, particulièrement pour les gens de ma génération, s’avère savoureuse. Il se dégage des notes, de sérénité dans la description de la nature omniprésente, de nostalgie, au gré des paragraphes ponctués des refrains de chansons de l’époque. Du roman d’apprentissage initial,
Yves Porthier-Rhétoré nous entraine, finalement, dans un habile roman policier. Cerise sur le gâteau, à la fin de cet ouvrage nous avons droit à un bonus, une étude sur les programmations télévisuelles balbutiantes de l’année : La TV de 1964 à travers Télé 7 jours.
Souvenirs, souvenirs….
Vous les copains, je n’vous oublierai jamais
Toute la vie, nous s’rons toujours des amis
[ …..]
Si un jour, nous sommes séparés
Nous, on sait que note cœur ne changera jamais
[…..]